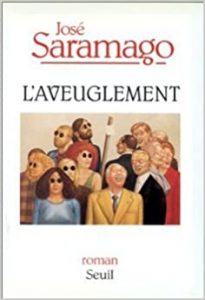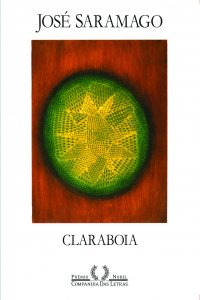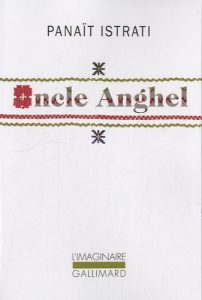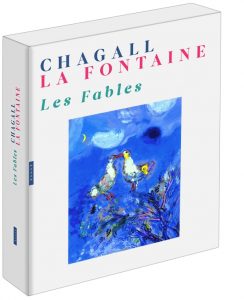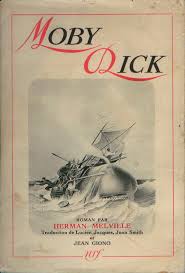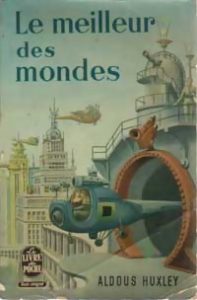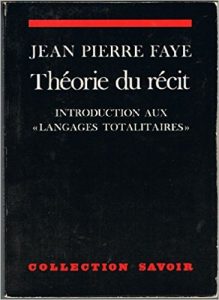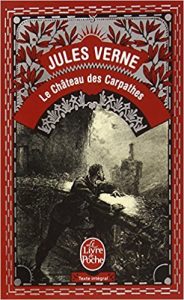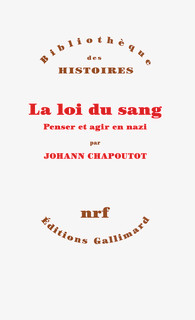Cette page n’obéit à aucun principe, sinon celui de n’obéir à aucun… Le choix de mettre en lumière certains ouvrages ne prétend à aucune espèce de scientificité, et ne résulte que du plaisir de la lecture, des réflexions qu’elle a pu suscité, parfois à son insu, et parfois de l’immense valeur heuristique que, personnellement, je peux leur attribuer. Ce qui compte ici n’est pas tant de dresser des comptes-rendus de lecture, mais de donner des impressions de lecture, à tort et à travers, hors des calendriers.
Cette page n’a pas été alimentée depuis 2022 : j’ai des impressions de lecture à écrire encore, mais j’ai eu aussi beaucoup de choses à écrire sur les histoires que l’on raconte, dans ou hors les livres. J’y reviendrai sans doute bientôt.
Impressions Printemps 2022
L’aveuglement
José Saramago
Ma première rencontre avec Saramago date d’il y a presque 20 ans, lorsque j’ai lu La lucidité. J’avais alors comme incroyable rêve d’adapter cette œuvre pour la scène, mais que je n’ai encore jamais entrepris de réaliser. Lorsque plus récemment j’ai lu L’aveuglement, c’est au contraire l’impossibilité de son adaptation que j’y ai vue, que ce soit au cinéma ou à la scène. A prendre cette histoire au sérieux, il s’agirait de faire vivre aux spectateurs ce qu’ils ne peuvent supporter à ce titre : l’odeur de la merde, de ces monceaux de défécations, pendant de si longues pages, et dont aucun personnage ne semble pouvoir s’abstraire, symbole de la faiblesse indicible de notre civilisation devant l’inattendu. L’humanité grippe devant l’incompréhensible et fait de ses membres des acteurs sans dignité possible. L’odeur donc s’installe à mesure que l’homme ne pense plus qu’à préserver sa vie physique. Elle ne se représente pas collectivement, et alors, comment signifier L’aveuglement ? Saramago est décidément un incroyable sondeur de l’homme social ne parvenant jamais vraiment à se figurer lui-même.
La volonté de savoir
Michel Foucault
Désigner quelque chose c’est indéniablement porter un regard sur cette chose, c’est la faire être cette chose qu’on désigne, qui aurait pris une autre signification si elle avait été désignée autrement. Truisme ? Peut-être. Mais on ne saurait l’oublier ou l’omettre sans prendre le risque de ne rien voir de ce que l’homme pense. C’est ainsi qu’en 1976 et 1994, un même ouvrage de Michel Foucault – mort entre-temps – ne se donne pas à voir à son public de la même façon, et il n’y a rien de fortuit à cela. Lorsque Michel entreprend l’histoire de la sexualité, il commence par nous dire qu’elle est, contre ou au moins en marge de l’idée qu’on peut l’y résumer à une histoire de répression, surtout une histoire publique et collective : La volonté de savoir, c’est moins l’histoire de la sexualité elle-même que notre histoire à propos de la sexualité, ou, comment est-ce que le collectif entreprend de faire de la sexualité de chacun non pas une histoire intime mais un lit-vre ouvert à la société , que cela passe ou non par la répression, la marginalité ou l’interdit. Il reprend ainsi volontairement le titre qu’il avait déjà donné à sa première série de cours au Collège de France (Leçons sur la volonté de savoir, Cours au Collège de France (1970-1971) publiée plus tard chez Gallimard, Seuil, 2011)
La couverture de la première publication de l’ouvrage donne ainsi à voir cette « volonté de savoir ». Quelques décennies plus tard toutefois, c’est L’histoire de la sexualité qui se donne à voir – comme d’ailleurs elles se donne à voir dans l’édition anglophone qui a carrément ignoré le titre originel en le réduisant à « An introduction » ((The History of Sexuality, Translated from the French by Robert Hurley, Pantheon Books, New-York, 1978) – et la volonté de savoir devient secondaire, comme si justement il ne fallait pas savoir que c’est bien ça qui nous importe. Si Michel Foucault avait voulu rendre visible ce qui ne l’était pas, sa postérité se charge de l’invisibiliser de nouveau. Pas pour tout le monde il est vrai.
Impressions d’hiver 2022
Le scarabée d’Or
Edgar Poe
Le scarabée d’or de Poe m’a fait penser à L’invention de Morel de Adolfo Bioy Casares, sans doute parce que j’en avais vu l’adaptation cinématographique quelques mois auparavant et que le sentiment diffus d’une île à la fois luxuriante et désertique en ressortait à peu près de la même manière. Le scarabée d’or est à la fois une histoire fantastique et un exposé de rationalité, mettant en scène un seul contre les autres, la raison contre le commun. On pense d’ailleurs un peu à Hergé et son Secret de la Licorne, suivi du Trésor de Rakham le Rouge, où le rationnel Tintin a la certitude qu’il y a un véritable trésor à découvrir au fond de la mer. Avec Le Scarabée d’or, une histoire proprement extraordinaire – la spécialité narrative d’Egdar Poe donc – se tissent les enjeux du « comment penser ? », sans qu’on soit certain à la fin de ce qu’il faut en attendre : la richesse retrouvée du héros dont on ne peut que louer l’opportunisme méritoire, est-elle pour autant l’assurance d’un avenir réjouissant ? Ses indéniables qualités à la fois intuitives et mécaniques n’en font-elles pas un homme inadapté à la socialité, que l’île sur laquelle il avait en quelque sorte échoué pouvait seule accueillir ? Je ne vois pourtant dans cette histoire aucune allégorie intentionnelle de la part de Poe, seulement une situation et des hommes aux prises avec les événements à travers lesquels ils se guident plus ou moins adroitement.
Chroniques du juste et du bon
Louis Assier-Andrieu
Je ne sais pas si Louis Assier-Andrieu range spécifiquement son travail dans une discipline. Quoi qu’il en soit, cet observateur du droit théorise, rassemble des éléments d’histoire, observe le droit en situations pour le moins particulières. Chroniques du juste et du bon est un recueil d’études de l’auteur, qu’il a retravaillées pour l’occasion. Chroniques d’interrogations (le cas de l’affaire Pitcairn évidemment), de liaisons entre ce qui se passe aujourd’hui et ce qu’il rapporte de la vie et de l’histoire du droit (La vie des morts de Cucurnis), de constats de certaines évolutions du droit (Justice ou marché : le dilemme des avocats), ces études peuvent être précieuses pour qui aime bien comprendre le droit au-delà des seuls énoncés formels du droit et au-delà de ce qu’en disent les juges. Mais Louis-Assier Andrieu a quelques difficultés à cacher son scepticisme vis-à-vis de beaucoup des évolutions contemporaines du droit, tout en paraissant faire montre d’une forme de (fausse) neutralité, graal superficiel de la scientificité, et c’est bien dommage qu’il s’en tienne à cette position. Cela s’apparente à ce qu’on dit toujours en « off » et qu’on ne doit surtout pas répéter, et qui est pourtant le nid de notre vérité pensante. Tout ça pour rien donc, si souvent. L’engagement ennemi de la science, hélas.
Impressions d’automne 2021
La lucarne (Claraboia)
de
José Saramago
J’aime peut-être plus les histoires autour des livres que les histoires dans les livres, mais il arrive souvent que les unes et les autres se conjoignent dans le remarquable. Ce fut par exemple le cas de L’usage du monde, que Nicolas Bouvier mit huit ans à publier (voyez plus loin cette page), et c’est le cas de La lucarne de José Saramago, celui par lequel il est sans doute devenu écrivain, usant des nuits qui lui restaient après le travail, lui qui, issu de parents pauvres commença à travailler à 16 ans comme serrurier, et qui souhaitait devenir journaliste. Il fut journaliste et écrivain. Envoyé en 1953 à l’éditeur, le manuscrit ne fut jamais renvoyé à Saramago, qui garda cet affront encré dans sa mémoire. Pourtant il devint bien écrivain, nobélisé même, et quant, à la dite faveur d’un déménagement de l’éditeur, le manuscrit fut retrouvé, son auteur refusa absolument qu’il soit alors publié. Non pas qu’il le trouvât mauvais ou le reniât (comme il le fit avec son premier écrit, Terra do pecado), mais qu’il semblait trouver ce procédé indigne. La lucarne avait pris à José Saramago une dizaine d’années d’écriture quasi-clandestine, entre différents emplois et entrée dans le monde du journalisme : l’opposé donc de La vie Mode d’emploi de Georges Perec, à qui il avait fallu aussi une dizaine d’année de gestation et d’écriture, mais sans clandestinité et au destin immédiat. Cette mise en perspective parce que les deux livres ont en commun de tourner autour des personnes habitant un même immeuble. Pour ceux qui connaissent et/ou aiment Saramago, on y retrouve son extraordinaire faculté à pénétrer les tréfonds de ce qui anime les hommes, sans haine et sans idéal, pour être au plus « juste ».
Oncle Anghel
de
Panait Istrati
Décidément il y en a de sacrées histoires. La première est celle que narre Joseph Kessel son préfacier, celle d’un homme « de peu » mais bourlingueur européen et méditerranéen dans ce début de XXè siècle, un homme à la fois expansif et entier dans tous ses sentiments. Moyennement éduqué et contraint au travail, il se rêve écrivain, et, après avoir été initié au français par un compagnon de maladie, envoie son manuscrit à son idole Romain Rolland, mais à une mauvaise adresse. Quasi suicidé, l’on retrouve sur lui une lettre encore adressée à Romain Rolland à qui on la fait finalement parvenir. La suite fait son œuvre, l’œuvre justement que l’idole français lui prie de bien vouloir alors réaliser. C’est dit, il sera un écrivain roumain écrivant en français. Oncle Anghel, sa deuxième histoire publiée, raconte des choses en tous points « excessives », comme Panait Istrati paraît lui-même l’avoir été. Si l’on retient l’histoire de ce bandit orgueilleux à la force quasi divine, de cette bergère laissée mère qui retourne incroyablement son destin, on ne peut oublier ce qui assoit tout le début du livre, à savoir la mise en scène de ce très vieux corps immobile et mangé de l’intérieur dont la présence et l’aspect ignobles ne semblent être là que pour attester de la force de ce qui semble ne pas s’y apparenter, l’âme, et qui pourtant ne lui survit pas. J’en suis sortie interrogative : tout ça pour quoi ? Pour rien sans doute, juste parce que c’est ainsi.
Le sel du présent.
Chroniques de Cinéma
de
Eric Rohmer
Tant de choses peuvent être dites à propos des raisons qui font aimer le cinéma tant il est divers. Rohmer avait ses raisons, qui l’ont fait être critique avant d’être lui-même cinéaste. Je ne me hasarderai pas à chercher le Rohmer cinéaste d’après dans le Rohmer critique d’avant, comme nous y invite pourtant la 4ème de couverture. Il suffit de prendre ses textes, souvent courts, pour ce qu’ils sont : un regard sur les propositions qui lui sont faites, selon une connaissance quasi-parfaite de l’histoire de cette pratique et une culture philosophique sûre, produisant une forme de classement en règle des déjà différentes sortes de cinémas qui s’élaborent à l’époque. Evidemment le cinéma des années 1950 n’est pas le nôtre, mais l’esprit critique lui n’a pas de patrie temporelle : il est presque toujours le même à travers les temps et ses objets, faisant que, souvent, « on s’y croirait ». Ce que Eric Rohmer sait dire peut donc nous toucher très efficacement. Ainsi quand, entre deux lignes, il évoque à peine le premier court-métrage de Jean-Luc Godard, provoquant l’envie irrépressible d’y aller voir, ou quand il pose simplement les bases d’un film de Fritz Lang dont on avait oublié même le souvenir. Parfois amèrement technique, quelque fois digressant, Eric Rohmer situe chaque film dans l’espace plus grand du cinéma, comme si cela se jouait à chaque fois.
Impressions estivales 2020
Chien Blanc
de Romain Gary, éd. Gallimard, 1970
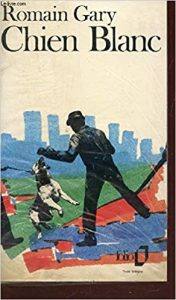 Cela devait faire 2 mois que j’avais sorti Chien Blanc de la bibliothèque pour le lire, mais l’humeur n’y était jamais. Il ne fait guère de doute que l’actualité livrée ces derniers temps – l’interpellation homicidaire du noir américain Georges Floyd par des agents de police – a eu raison de mon humeur et j’ai lu Chien blanc. Constamment sur le fil du rasoir, voilà comment je pourrais décrire l’écriture de Romain Gary dans ce livre, roman dit d’autofiction où, comme presque toujours avec cet auteur, on ne sait jamais s’il dit vrai et si c’est bien de lui dont il parle. Depuis l’assassinat de Martin Luther King, jusqu’aux pavés de mai 1968 en passant par la trame Vietnamienne, Beverly Hills et la rue du Bac à Paris, Chien Blanc est une ouverture constante sur les rapports entre les hommes, entre les hommes blancs et les hommes noirs, entre les hommes noirs, entre les hommes et les femmes, entre les femmes blanches et les femmes noires ; des rapports dans leur crudité (les pages sur les faits coloniaux en Afrique sont des rappels historiques qui devraient constituer les rudiments de l’apprentissage de l’histoire), mais aussi médiatisés par un chien, ce « white dog » élevé pour agresser les personnes noires de peau. Les mots et réflexions, qui paraissent posés au jour le jour, avec peu de fard, par un homme dont on ne sait s’il se moque toujours de lui-même, s’il se sent écrasé par son incapacité à être, penser ou dire autrement, sont, quoi qu’il en soit, « justes » dans ce dont ils parlent. Les situations sont décrites pour et par ce qu’elles sont, pas par ce qu’elles paraissent. Tout y passe, et cela peut être perturbant car on finit par ne pouvoir s’arrêter sur rien. De toutes les façons serait-ce possible à propos de l’histoire de l’humanité ? Il y a de la détresse dans cette écriture si fine et si vivante. Je remarque vite l’absence de l’enfant dans cet ouvrage. Une vie à se voir c’est difficile. D’ailleurs, et bien que ça ne soit pas le sujet du livre – quoique ça en soit précisément le sujet – Romain Gary incise dans Chien blanc cet auto-portrait fébrile : « C’est terrible l’émigration. Ça vous rend consul général de France, prix Goncourt, patriote décoré, gaulliste, porte-parole de la délégation française aux Nations-Unies. Terrible. Une vie brisée. »
Cela devait faire 2 mois que j’avais sorti Chien Blanc de la bibliothèque pour le lire, mais l’humeur n’y était jamais. Il ne fait guère de doute que l’actualité livrée ces derniers temps – l’interpellation homicidaire du noir américain Georges Floyd par des agents de police – a eu raison de mon humeur et j’ai lu Chien blanc. Constamment sur le fil du rasoir, voilà comment je pourrais décrire l’écriture de Romain Gary dans ce livre, roman dit d’autofiction où, comme presque toujours avec cet auteur, on ne sait jamais s’il dit vrai et si c’est bien de lui dont il parle. Depuis l’assassinat de Martin Luther King, jusqu’aux pavés de mai 1968 en passant par la trame Vietnamienne, Beverly Hills et la rue du Bac à Paris, Chien Blanc est une ouverture constante sur les rapports entre les hommes, entre les hommes blancs et les hommes noirs, entre les hommes noirs, entre les hommes et les femmes, entre les femmes blanches et les femmes noires ; des rapports dans leur crudité (les pages sur les faits coloniaux en Afrique sont des rappels historiques qui devraient constituer les rudiments de l’apprentissage de l’histoire), mais aussi médiatisés par un chien, ce « white dog » élevé pour agresser les personnes noires de peau. Les mots et réflexions, qui paraissent posés au jour le jour, avec peu de fard, par un homme dont on ne sait s’il se moque toujours de lui-même, s’il se sent écrasé par son incapacité à être, penser ou dire autrement, sont, quoi qu’il en soit, « justes » dans ce dont ils parlent. Les situations sont décrites pour et par ce qu’elles sont, pas par ce qu’elles paraissent. Tout y passe, et cela peut être perturbant car on finit par ne pouvoir s’arrêter sur rien. De toutes les façons serait-ce possible à propos de l’histoire de l’humanité ? Il y a de la détresse dans cette écriture si fine et si vivante. Je remarque vite l’absence de l’enfant dans cet ouvrage. Une vie à se voir c’est difficile. D’ailleurs, et bien que ça ne soit pas le sujet du livre – quoique ça en soit précisément le sujet – Romain Gary incise dans Chien blanc cet auto-portrait fébrile : « C’est terrible l’émigration. Ça vous rend consul général de France, prix Goncourt, patriote décoré, gaulliste, porte-parole de la délégation française aux Nations-Unies. Terrible. Une vie brisée. »
Le Decameron
par Giovanni Boccacio, 1349-1353
Désuet, olympien et léger, le Decameron met en scène les dix journées de villégiature de quelques jeunes gens, garçons et filles, issus de bonnes familles, en temps de peste. Les récits que font chaque jour tous les participants de cette retraite au ton joyeux ont en commun de mettre l’accent sur la tromperie, ou plutôt le semblant. Chacun sait que les choses ne sont pas telles qu’on les prétend dites, mais les jugements à leur propos sont pourtant faits comme s’il en était ainsi. Si les membres de l’Eglise n’ont pas la vertu qu’ils disent, la plupart font « comme si » ; si les femmes – pas plus que les hommes – ne sont pas toujours fidèles, on fait encore comme si. Boccace décrit une société minée par le semblant, sur lequel toutefois elle construit ses bases les plus solides semble-t-il. Le protagoniste de l’une des nouvelles distillées chaque jour, juif de son état, ne conclut-il pas que les fondements de la religion catholique doivent être bien riches pour survivre à la corruption généralisée de ses personnels ? Son ami, qui voulait l’y convertir, n’avait pas pu éviter qu’il allât au Vatican pour se faire la «meilleure » idée possible de cette religion, et pensait donc la cause perdue. Au contraire, elle fut renforcée.
Chagall
La Fontaine – Les fables
On m’a offert ce coffret pour mon anniversaire : « bien vu », comme a coutume de le dire celui qui me l’a offert et à qui quelques années auparavant j’avais moi-même offert l’histoire de Daphnis et Chloé illustrée par Chagall. Les gouaches et les eaux fortes qu’il réalise pour Les fables de la Fontaine sont tout simplement un trésor dans lequel on semble pouvoir éternellement puiser. Et comme si ça ne suffisait pas, j’ai été touchée par l’histoire qui accompagne cette œuvre (exposée par Ambre Gauthier), peut-être parce que je suis sensible à tout ce qui ne semble pas pouvoir se faire et finalement se fait, dans un temps parfois très long. J’ai déjà fait allusion à l’incroyable parcours de L’usage du monde de Nicolas Bouvier (voir plus bas cette page sur mes Impressions de lecture), et celui de ces illustrations de Chagall n’est pas moins chaotique. Depuis les reproches engrangés par le fait qu’un russe illustrait un monument de la culture française, jusqu’à l’impossibilité technique première de reproduire les incroyables gouaches, il aura fallu au total 35 ans depuis l’initiative de l’éditeur Ambroise Vollard en 1927 jusqu’à la publication des fables avec les illustrations de Chagall en 1952. Et dans cette histoire, on a aucune idée de comment la sélection de ces 100 fables a été faite… il y a donc juste à regarder. Parmi les dernières fables illustrées, La souris métamorphosée en fille se termine ainsi :
Parlez au diable, employez la magie,
Vous ne détournerez nul être de sa fin
Dont acte.
Acheminement vers la parole
Par Martin Heidegger, 1976, Gallimard, 1981
Cet ouvrage est le dernier publié par Martin Heidegger, qui réunit 6 conférences et essais réalisés entre 1950 et 1959 sur la parole. Il bénéficie d’une traduction française ciselée (Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier et François Fédier), en ce qu’elle fournit les outils pour ne pas être enfermé dans les termes, ni ceux à traduire ni ceux du traducteur. Cette ouverture toujours possible perturberait certainement la lecture d’un roman mais elle arrime au contraire celle d’une réflexion au caractère traditionnellement dit métaphysique. Ce qui me semble être la trouvaille contenue dans le titre « Acheminement vers la parole » pourrait presque suffire à chercher à reconstituer une partie des élaborations de ce recueil. Parmi les textes, celui consacré au dialogue « Entre un japonais et un qui demande », intitulé principalement « D’un entretien de la parole », est peut-être le plus dense, le plus plein d‘opportunités, le plus difficile aussi, un texte dont l’étude approfondie pourrait même prendre des années, sans qu’il paraisse se tarir. Cet « acheminement » fait le pari que plusieurs passages sont souvent nécessaires pour voir toujours des choses différentes à chaque fois. C’est peut-être comme presque tout, il faut revenir sur les mêmes gestes, les mêmes lieux, les mêmes idées, toujours et encore, pour espérer y voir quelque chose de plus. Une pensée qui ne supporte pas l’instantané, l’immédiateté du jugement à laquelle toutes les procédures du monde contemporain nous astreignent, où que l’on soit, quoi que l’on fasse. Difficile de ne pas s’y soumettre, difficile aussi de ne pas y croire dans nos pratiques. Il y a des choses que l’on voit au premier coup d’œil c’est vrai. Mais tellement plus nombreuses sont celles qu’on ne voit pas. L’acheminement est un acte sociétal contraire aux croyances qui font le quotidien de nos vies d’occidentaux, ce quotidien qui espère coloniser le monde.
Moby Dick,
Par Herman Melville, 1851
Dans une boutique du type Emmaüs je trouve il y a quelques semaines Moby Dick, publié par Gallimard en 1941 avec la traduction de Lucien jacques, Joan Smith et JEAN GIONO, que j’écris en capitales puisque c’est ainsi qu’il est écrit sur la page de couverture. Les premières pages ne sont pas coupées, celles qu’Herman Melville semble vouloir infliger à ses lecteurs avant le commencement de l’histoire, qui en est bien une puisque commençant par « Mirages ». Les pages qui précèdent donc sont une collection d’extraits pris dans tout type de littérature et qui parlent de la baleine et du Léviathan, puisque dans le roman, les deux termes sont quasi-synonymes : romans, bible, théâtre, récits de voyage, inventaires animaliers, almanach… je me dis que le lecteur avant moi, s’il y en a eu un, s’est privé de ces 14 pages. Dommage. Elles sont un peu à l’image du livre qui tour à tour se fait récit d’ambiance, récit d’aventure, almanach, fiches pratiques, réflexions philosophiques, morale sociale et même théorie du droit : contre toute attente, le chapitre LXXXXIX intitulé « poissons attachés et poissons perdus » est un exposé des principes qu’ont posé « les pêcheurs américains », qui ont été « leurs propres législateurs et juges », et ont ainsi « fourni un système qui, par l’élégance et la netteté de son esprit, surpasse les pandectes de Justinien et les Règlements de la Société Chinoise, pour supprimer l’ingérence dans les affaires d’autrui ». Je vous laisse découvrir la suite si vous ne la connaissez pas. Mais le point commun à beaucoup de moments du livre est une volonté démonstrative de Melville, qu’il sait pourtant vaine : « je voudrais simplement faire admettre que », « comme nous avons vu », « mais nous pouvons toujours faire des hypothèses, même s’il n’est pas possible de les prouver et de les certifier »… allons bon, a-t-on vraiment toujours besoin de preuve pour savoir, ou pour saisir très précisément ce qui se dit « par hypothèse » ? Je retiens donc ces quelques formules, il y en a certainement d’autres :
Car ce qu’il y a de vraiment merveilleux et de terrible dans l’homme n’a jamais encore été traduit par les mots ou mentionné dans les livres (chap. CX)
Au milieu de l’impersonnabilité générale, ici se tient quelqu’un (chap. CXIX)
Qu’y a-t-il de vrai en dehors des pensées impondérables ? (chap. CXXVII)
Impressions estivales 2019
Cette fois l’écriture a pris le pas… alors d’autres s’en sont chargé, et c’était vraiment bien : Marguerite Duras, La Maladie de la mort, le 5 août 2019.
Impressions estivales 2018
La continuation de l’écriture de mon propre ouvrage aurait pu prendre le pas sur le temps de la lecture cet été, mais le moment de la lecture a finalement pris le pas, puisque, tous les matins : soleil levant derrière la montagne, maisonnée encore endormie, fracas d’un jardin réveillé depuis longtemps ; en bref, l’assemblage parfait pour goûter comme il se doit à la solitude de la lecture. Je vous passerai le manuel de droit rural absorbé pour la bonne cause, ou quelques lectures techniques et historiques, pour ne vous livrer que quelques impressions donc, des sensations aussi, à propos de quelques autres de ces lectures estivales ou des pensées sur des lectures plus hivernales.
Aldous Huxley,
Le meilleur des Mondes (Brave New World), 1932
Vivre c’est charrier avec soi des pensées, des informations, des obligations, toutes plus ou moins utiles, toutes plus ou moins envahissantes, et le temps passé à faire du « tri » laisse souvent des marques. C’est pour cela que les moments où l’on se permet de ne pas faire le tri et ainsi de « laisser venir », sont très souvent vivants, lorsque s ‘écoute, contre toute raison immédiate, ce qui semblait traîner là sans utilité. Ce fut très récemment le cas pour ce Brave New World d’Aldous Huxley. Il y a très peu de temps j’avais entendu à la radio – et donc gardé en mémoire – que, entre Orwell et Huxley, c’était finalement peut-être Huxley qui était le plus juste dans sa lecture de l’avenir. Pour ma part, c’était surtout Orwell que je gardais le plus en mémoire, pour cause de Big Brother un peu, et de Novlangue beaucoup, que Klemperer décela notamment par son analyse de la langue du IIIè Reich. Il faut dire que je m’y étais reprise à plusieurs fois pour lire 1984, alors que mon souvenir de Le meilleur des mondes, restait finalement assez « léger », prolongé par le souvenir de l’univers aseptisé du film Bienvenu à Gattaca. Un long préambule pour dire que d’une minute à l’autre je ne savais pas que j’allais lire ce livre, que j’en eus l’idée sans doute par l’effet d’une pensée gardée en tête qui se rappelait soudainement à moi, et que donc je m’y suis mise le lendemain pour le lire quasi d’une traite. Les quelques heures de lecture ont été très « sensationnelles », à la fois sensorielles et introspectives : d’abord la sensation de me dire que le monde personnel dans lequel j’étais lorsque je l’avais lu la première fois était devenu quasi inconnu de moi, impalpable, et que c’est assez étrange de se dire cela, à la limite du vertige. Ensuite la première surprise de voir que la notion de dystopie, qui qualifie souvent le récit de Huxley, ne correspond pas à son ambition qui était précisément de décrire une utopie, la pire chose étant pour lui qu’elle se réalise (voir sa nouvelle préface), ce qui introduit une nouvelle manière d’envisager les choses, plus fine que la simple description d’un horrible monde. Je crois que la plus grande popularité d’Orwell est précisément due à son plus grand manichéisme de la pensée. Le rapport entre le monde « post-fordien » que décrit Huxley et le personnage du sauvage qui le lit de son dit point de vue de sauvage n’a rien de manichéen : le sauvage, pensant se sauver, finit par s’embrigader dans un système de pensée dans lequel il détermine sa propre place par rapport à un Dieu imaginé – qui le conduit à se flageller – et au monde civilisé duquel il veut échapper, pour finalement se pendre. Le récit laisse ainsi bien de la place pour penser le « bien », le « bonheur », le « mal », le « malheur », et aussi pour s’extraire de l’alternative impossible. Reste maintenant à parler des mécanismes du monde décrit par Huxley où précisément tout le monde serait heureux. Je laisse à chacun déterminer ce qu’il peut penser de leur actualité, qui ferait de Huxley un fin analyste de la condition de l’homme moderne.
Michel Foucault, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir (1984), éd. Gallimard, 2001.
On a beaucoup dit que l’angle mort de la pensée de Michel Foucault était le droit, et les juristes ont longtemps cherché à dire le droit à partir de Michel Foucault via des analogies un peu hasardeuses. Deux publications récentes font toutefois beaucoup mieux que cela (….).
Mais cette année j’ai lu deux fois La volonté de savoir, le premier tome de son Histoire de la sexualité. J’ai là affaire à l’état presque dernier de la pensée de Michel Foucault, et c’est dans ce tome 1er qu’il articule à mon avis une pensée très précise sur le droit (en le mettant en partie à sa juste place), déjà en germe dans des ouvrages ou cours plus anciens (le plus important étant de mon point de vue Naissance de la biopolitique, cours de 1978-1979 au collège de France, dont je signale – et conseille vivement l’écoute – qu’il existe aujourd’hui un enregistrement sonore presque parfait en ligne sur youtube). Lire Michel Foucault lorsqu’il parle de ce qu’il croit déceler dans le fonctionnement de la société et son histoire change des innombrables facilités dispensées dans la littérature intellectuelle contemporaine. Lire Foucault n’a strictement aucun intérêt si on ne s’y arrête pas pour mettre en rapport ce qui y est dit et ce qui nous fait vivre. Il n’est pas nécessaire de s’affirmer Foucaldien ou anti-Foucaldien (il semble qu’il souhaitait ne pouvoir jamais être rangé nulle part) pour enrichir sa propre pensée : on peut découvrir que son propre chemin suit un temps celui d’un autre, et continuer sa route. Le titre du tome 1er est doublement juste , qui s’applique tout autant à cette histoire qui évolue en mettant l’intime et la sexualité au cœur d’un dispositif qui implique la connaissance de la sexualité de tous, qu’à ceux des lecteurs qui ne voudraient pas rester dans l’ignorance de ces mécanismes qui ne sautent pas aux yeux, car il faut avoir travaillé un regard en biais – et en tripes peut-être – pour les mettre à jour.
Ecrire le livre déjà écrit, libres propos sur deux ouvrages universitaires français parus en 2017.
Il y a quelques mois j’ai lu deux livres écrits par des universitaires, intellectuels reconnus dans leurs spécialités (la philosophie et la science politique) sur deux sujets sinon éloignés, tout de même un peu différents. Leurs auteurs ont eu tous l’occasion de parler de leur ouvrage sur l’antenne de la radio préférée des intellectuels français (plusieurs fois) et on peut dire qu’ils ont ainsi « pignon sur rue » dans ce milieu, et les uns et les autres ont été primés ou taxés de vision en quelque sorte « neuve » ou « autre ». Ce pedigree devrait présager de ce que là on va réfléchir, apprendre, s’élever. Mais voilà que les essais (d’)universitaires semblent s’être transformés en de bons ouvrages pédagogiques, qui certes demandent des qualités certaines pour être rédigés de la sorte, mais, en tout état de cause n’ajoutent rien à l’existant : leurs auteurs ont écrit des livres qui l’étaient en réalité déjà. Ce qui m’a amené à cette conclusion est le fait d’abord de constater qu’ils étaient tous deux construits exactement selon le même canevas : quelques constats, quelques bonnes questions en guise d’introduction (assez longue), puis un parcours historico-intellectuel sur le sujet dans les chapitres qui suivent, et une conclusion courte et répétitive. La similarité des constructions et du « mode d’action » est frappante, et peut sans doute être reproduite à l’infini, sur tous les sujets à « idées », parce qu’il s’agit surtout de répertorier – toujours avec talent – ce qu’en ont dit d’autres depuis des siècles, de préférence ceux entrés dans le panthéon de la pensée. L’histoire des idées se substitue ainsi à la réflexion et l’essai universitaire n’est rien de plus qu’une dissertation de très bon élève. « Rien sur la table » n’a été mis par leurs auteurs, qui viendrait d’eux. Seulement une ligne supplémentaire sur la liste de leurs publications.
Depuis quelques temps dans l’écriture d’un ouvrage qui serait le mien seul, il me semble que la moindre des choses est d’aller chercher ce qui pourrait être dit qui ne l’a pas été, ou pas comme ça, ou pour d’autres raisons, qui donnent au lecteur l’opportunité d’y réfléchir aussi, plutôt que d’y être conduit à propos du fait qu’il n’y avait justement pas « matière à »
Vincent Denis, Une histoire de l’identité. France, 1715-1815, Seyssel, Champ Vallon et Société des études robespierristes, 2008
Voici bien un travail important de fouille et de recherche sur la question des pratiques, locales et nationales d’identification des personnes. L’ouvrage est essentiellement composé du résultat de ces recherches, guidé par quelques questions tout à fait essentielles, à l’instar de celle sur la pratique du « signalement » qui, dit l’auteur, « porte en elle les contradictions inhérentes à tout projet d’une science de l’homme : comment décrire précisément et objectivement un autre soi-même ? ». L’histoire de Vincent Denis insiste à la fois sur les pratiques et sur leurs mobiles (la sécurité bien sûr), à travers un fil continu qui semble très tôt comme irréversible. Au-delà, le lecteur peut continuer de s’interroger sur ce qui fait fondamentalement soi et autrui, et surtout la capacité de le dire de manière uniforme : peine perdue donc que de vouloir construire une science de l’identité, et illusion contemporaine maintenue de l’objectivité, qui rejette chacun hors de sa race mais le cible de plus en plus par sa sexualité (l’état conjugal et la filiation) ? Numéroté, bien sûr, immatriculé depuis longtemps, la vie de l’homme contemporain est codée, inscrite par des nombres desquels en fin de compte il tire de plus en plus la capacité de s’ignorer comme sujet. Le lien entre la technologie et la conception administrative de l’identité apparaît constant, qui atteste de ce que l’homme se pense de moins en moins comme homme mais de plus en plus comme l’objet de son temps. Les nombreuses réflexions à ce sujet pourraient s’envisager comme des contre-exemples, quand elles sont seulement le signe de ce que l’on n’est pas encore allé jusqu’au bout de la logique, ou du moins qu’on pense ne pas y aller.
Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, Édité par Fabienne Brion et Bernard E. Harcourt, Presses Universitaires de Louvain et University of Chicago Press, 2012.
Encore Michel Foucault dans mes impressions de lecture : il faut dire qu’il y a des moments où l’activité de lecture n’a aucune raison d’être « à vide », et alors d’aller chercher ce qui fait absolument partie de « la base ». Il y a des moments où, comme dit dans la note précédente, on n’a pas envie de lire ce qui reste « facile », quoique pas toujours compréhensible : la complexité des termes et des constructions est d’ailleurs presque toujours une condition pour affirmer la fausse facilité et la complexité d’un sujet et d’une pensée, de laquelle finalement on finit par ne rien savoir. Tandis que la pensée de Michel Foucault est très souvent d’une lumineuse simplicité, mais – presque – partout ignorée. Cet ouvrage regroupe une série de conférences faites par Michel Foucault à l’Université de Louvain en 1981, ainsi qu’une introduction et un long texte des éditeurs sur la pensée de Michel Foucault. Comme à son habitude, via un œil en biais sur les idées et les pratiques historiques, il décrypte et révèle une autre manière d’envisager des pratiques et des objets sociaux, que chacun peut saisir. L’aveu est de ces pratiques pour laquelle Foucault voit une évolution, à la fois de son objet même et de sa fonction : par exemple – et pour le rapporter ici à la fois grossièrement et simplement – il ne s’agit plus seulement de se déclarer auteur d’un fait, il s’agit aussi de se dire soi, de livrer un pourquoi, sans lequel la fonction de juger paraîtrait insensée. Cette évolution est à mettre en lien – comme toujours – avec d’autres, et avec la structuration de l’espace social dans son ensemble. Bref, une pensée non fragmentée, qui oblige.
Impressions estivales 2017 (2)
Voici une deuxième livraison des impressions estivales, avant l’hiver et alors que la nature honore les parisiens notamment de quelques beaux jours supplémentaires. J’ai fait quelques choix, toujours personnels.
Amos Tutuola, L’ivrogne dans la Brousse (1953 en français, avec la trad. de Raymond Queneau), Gallimard, 2006.
Un tel titre peut repousser la lecture ou au contraire l‘encourager. Mais comme si souvent, ce sont les circonstances qui poussent à la lecture. Le dernier jour de vie du Musée Dapper à Paris au mois de juin dernier fut pour moi la bonne circonstance : précédent tout juste l’occasion de fêter un parent, j’acquis pour cela ce petit ouvrage à la librairie du musée sur les conseils de mon compagnon. Je lui empruntai du même coup le sien propre pour le lire pendant la saison estivale qui s’annonçait. Bien m’en avait pris puisque, traduit de l’anglais par Raymond Queneau, cet ouvrage peut se dire une odyssée dans l’espace du surnaturel africain. Un souvenir plus présent que les autres dans ce livre : celle de cet homme qui, revenant du marché et repartant dans la forêt, suivi par le héros du livre, se « démembre » progressivement pour n’être finalement plus qu’un crâne, le reste de corps étant pur emprunt pour aller à la ville… je ne sais si un esprit africain pouvait seul décrire un pareil procédé, mais je sais qu’il me paraît très humain.
 Et Pour le plaisir…une pièce maîtresse du musée Dapper
Et Pour le plaisir…une pièce maîtresse du musée Dapper
Elisabeth Roudisnesco, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, Points Essais, 2014.
Elisabeth Roudinesco est historienne de la psychanalyse et présente la très grande particularité d’être reconnue comme telle par les différents courants qui semblent traverser la pratique dite psychanalytique. L’ouvrage est long certes, mais il semble qu’il fallait bien cela pour « faire le point sur » la vie et la personnalité de Freud (584 pages avant bibliographie). On se demande souvent à la lecture « où se situe » l’auteure, comme s’il était impossible de ne pas prendre parti. L’impression qui demeure pour moi est cette double et apparemment incompatible impression que Freud ne savait absolument pas ce qu’il faisait réellement, tout en le sachant et en l’affirmant très bien. Me voilà bien prise dans les rets de la psychanalyse qui fait coexister ce qui ne nous paraît pas à première vue coexister. Bref, un ouvrage parfois passionnant (j’aurai l’occasion de parler d’un épisode illustrant pour moi la fameuse « Vienne fin de siècle »). Bonne lecture ! Nicolas Bouvier, L’usage du Monde (1963), éd. La Découverte, 1994.
Nicolas Bouvier, L’usage du Monde (1963), éd. La Découverte, 1994.
La dernière fois j’ai indiqué que Nicolas Bouvier avait mis 35 ans pour écrire Le Poisson-Scorpion (voy. plus bas cette page). Eh bien il lui a fallu 8 ans et quelques déconvenues pour obtenir une publication digne de ce nom de L’usage du monde, aujourd’hui célébré dans les meilleurs milieux littéraires. Je renvoie pour l’histoire à cet article paru dans L’express : http://www.lexpress.fr/culture/livre/comment-italique-l-usage-du-monde-italique-est-devenu-un-livre-culte_809125.html
Pour l’heure, l’usage du monde est un vrai carnet de voyage, à la fois modèle et naturellement irreproductible. Le récit « sent » quelque chose incontestablement, à l’instar de la décharge dans laquelle il fouille avec son compagnon de voyage dans l’espoir incertain de retrouver ses cinquante feuillets de notes destinées à servir pour l’écriture de l’ouvrage. Il ne le retrouve pas et force ainsi l’admiration, par son obstination et l’importance qu’il y a de les retrouver, cohabitant avec la présence du récit finalement écrit et publié. Il instille et intime une sorte d’urgence à faire la seule chose qu’il pouvait finalement faire. Nicolas Bouvier parle des lieux et des gens qui le peuplent comme nul autre. Peut-être parce qu’il attache, sans artifice semble-t-il, de l’importance à ce qu’il veut.
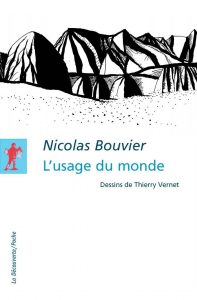 Jean-Pierre Faye, Théorie du récit : introduction aux « langages totalitaires ». La raison critique de l’économie narrative, Hermann, 1972
Jean-Pierre Faye, Théorie du récit : introduction aux « langages totalitaires ». La raison critique de l’économie narrative, Hermann, 1972
Ma référence en la matière est évidemment l’ouvrage de Viktor Klemperer, L.T.I., la langue du 3ème Reich, dont je parle notamment ici .
C’est une première surprise de constater que Jean-Pierre Faye ne cite pas cet ouvrage, mais il est vrai que la L.T.I. n’a été publiée en Allemagne réunifiée qu’en 1995 (dès 1947 en RDA) et en 1996 dans sa traduction française. Mais la démarche de l’auteur, qui n’est pas philologue, contrairement à Viktor Klemperer, est un peu « autre », qui consiste surtout à démonter les discours à partir du concept de vérité et d’économie narratives, tandis que Klemperer analyse les ressorts du langage révélant la réalité du discours et des intentions du discours. L’ouvrage de Jean-Pierre Faye est en ce sens historique, tandis que celui de Klemperer est éternel. Mais l’un n’empêche pas l’autre, heureusement.
Impressions estivales 2017 (1)
Il était difficile cet été d’échapper au visage et au nom de certains « hauts » personnages du Monde que précisément Le Monde se fait un devoir d’imprimer chaque jour. Pas de pause donc. Seules des terres rocailleuses, escarpées, et pour ainsi dire inhabitées – ou presque – pouvaient constituer un point de chute de tout cela. Voici ici quelques impressions de ces lectures en et d’Altitude, dont l’assemblage en un court moment est un cru peu ordinaire.
Nicolas Bouvier, Le poisson-scorpion, Gallimard, 1985.
Il y a peu Nicolas Bouvier est entré au programme de l’agrégation de philosophie pour L’usage du Monde, dont je parlerai dans les prochaines impressions de lecture. J’ai décidé de commencer par la fin en lisant Le Poisson-Scorpion, ouvrage qu’il a fallu à son auteur 35 ans pour écrire, tant fut dense l’expérience qu’il a vécue lors du voyage qui fait l’objet de ce récit, expérience douloureuse aussi, et presque hors du temps. Il est heureux qu’il soit parvenu à l’écrire. Certains savent peut-être que le tabac tout juste au réveil a une propension à mettre littéralement la tête à l’envers pour quelques instants. La lecture du Poisson-Scorpion au réveil et sans préambule relève de cette sensation. A essayer sans modération. Nicolas Nouvier tente d’y dépeindre un lieu inimaginable, puisque personne ne semblait vouloir le croire ; il se familiarise avec la population très grande des insectes qui partageaient alors son logis en en faisant des descriptions d’une précision poétique hors du commun ; il dégage de ce qu’il vit un substrat unique. Ce poisson-scorpion est un peu à l’image de l’animal auquel il emprunte son nom : fait de piquants et de dentelles dirait-on, son imagerie est familière aux parcoureurs d’aquariums zoologiques mais personne ne le voit, et donc ne le lit, de la même manière.
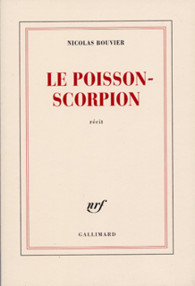 Jacques Lacan, R.S.I., séminaire 1974-75, document de travail disponible sur le site de Patrick Valas (http://www.valas.fr/)
Jacques Lacan, R.S.I., séminaire 1974-75, document de travail disponible sur le site de Patrick Valas (http://www.valas.fr/)
Je ne pense pas qu’on puisse vraiment entamer et surtout poursuivre la lecture de Lacan « au hasard ». Pour moi, la lecture de Lacan et celle de ce séminaire en particulier était provoquée autant qu’appelée. Je ne crois pas non plus qu’on puisse commencer Lacan « par le bon bout » : aucun et tous à la fois permettent de dérouler un fil, non continu d’ailleurs. Ce fil justement, dans R.S.I. (pour Réél, Symbolique e Imaginaire), Lacan envisage la manière de le nouer, la manière dont précisément et pour chacun se nouent le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire, nouage représenté par le fameux « nœud borroméen ». Le manuscrit (établi à partir de notes prises par les auditeurs du séminaire) reprend les nombreuses représentations de ce nœud tentées par Lacan à l’occasion du séminaire et aucun des 3 fils n’est spécifiquement lié à l’un des deux autres puisqu’il s’agit d’un agencement en permanence renouvelé.
L’entame de cette impression de lecture, « je ne pense pas » et à la suite, « je ne crois pas », est une nécessité de la lecture – pari presqu’impossible – qui consiste à accepter l’incertitude d’un sens qui échappe, pluriel et propre à chacun, encore une fois.
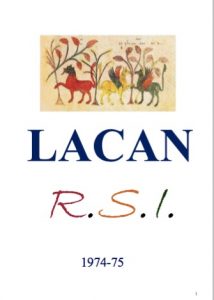 Jules Verne, Le château des Carpathes, J. Hetzel et Compagnie, 1892
Jules Verne, Le château des Carpathes, J. Hetzel et Compagnie, 1892
Les « classiques » lus lors de la scolarité sont trop souvent victimes de la jeunesse de leur lecteur. Ce château des Carpathes m’est tombé dans les mains je ne me souviens plus très bien comment. Sans doute l’ainé qui l’aura laissé à la vue de tous. Quoi qu’il en soit je me suis régalée de manière inattendue : richesse réjouissante du vocabulaire et des descriptions, étrangeté de la narration peut-être, plongée dans un monde semi-rural un peu désuet – Il ne fait pas de mal d’aller vaquer un peu vers la frustrerie d’un autre temps, même imaginaire, suivi pas à pas d’une ascension fantastique vers ce château, pour un dénouement (après Lacan !) finalement un peu attendu pour des lecteurs contemporains.
Muchielli, Le mythe de la cité idéale, PUF, 1960.
Voici un classique parmi les classiques de la littérature des sciences sociales et considéré comme une contribution importante à l’étude de l’utopie dans l’histoire de la pensée. L’intérêt de l’ouvrage est d’explorer à travers les âges tous les mouvements de pensée ayant eu en commun une aspiration à une « meilleure » cité et leur articulation avec l’action. Ce n’est donc pas seulement de philosophie, de littérature ou de sociologie dont il est question, mais aussi de mouvements politiques ou religieux, à l’instar de la réforme. On peut ainsi y piocher des idées, et l’espace laissé au développement de sa propre réflexion est finalement assez grand, ce qui est souvent le propre d’une pensée discrète. Un manuel autant qu’une histoire.
 Michel Miaille, Introduction critique au droit, Maspero, 1977,
Michel Miaille, Introduction critique au droit, Maspero, 1977,
Cette Introduction critique au droit est vraiment un « classique », et pourtant je ne connais pas beaucoup d’étudiants de première année en France à qui cette introduction est vivement conseillée, autrement que de manière secondaire, et encore moins d’étudiants de 1ère année qui l’auraient lue. Symbole de la critique néomarxiste du droit, dénonçant la bonne parole servie dans les facultés de droit et le caractère particulièrement idéologique du droit, des institutions et de leur enseignement, cet ouvrage doit être lu pour ce qu’il est : une critique. Les choses ont fait que, à proprement parler, il n’y ait pas vraiment eu, de la part des juristes j’entends, d’autres véritables critiques du droit à présenter aux étudiants de première année. Du coup, on préfère continuer à délivrer la bonne parole. C’est très dommage quand même, mais cela conserve toute son actualité à cette Introduction critique, que je conseille à tous vivement.
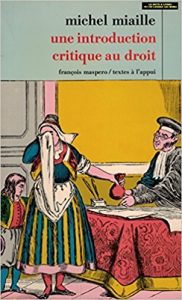 Samuel Bénisty, La norme sociale de conduite saisie par le droit, LGDJ, coll. Fondation Varenne, 2014
Samuel Bénisty, La norme sociale de conduite saisie par le droit, LGDJ, coll. Fondation Varenne, 2014
On peut attendre beaucoup de ce type d’ouvrage, et encore plus à la lecture de sa préface qui nous promet monts et merveilles. On doit se réjouir de ce qu’un juriste entreprend, pour devenir universitaire, de s’intéresser et de rassembler le must de la littérature un « peu décalée », c’est-à-dire peu « technique », sur le droit. Sont ainsi parcourus presque tous les sociologues, anthropologues et ethnologues du droit, pour l’essentiel francophones, auxquels l’espérance d’un crédit plus grand auprès de l’ensemble de la communauté universitaire peut être attendue. L’ambition du propos et son point d’arrivée ne me sont hélas pas apparus clairement, et ce que j’aurais pu attendre de valeur proprement heuristique sur le droit est finalement resté – au corps défendant je n’en doute pas du tout de son auteur – dans le confort de la pensée sur le droit, qui maintient et maintiendra assez scrupuleusement séparés les différents types de réflexion sur le droit. C’est un peu dommage tout de même.
Avril 2017
Michel Foucault, Les mots et Les choses, 1966.
Qu’est-ce qui frappe à la relecture de ce classique ? Ce qui évidemment parle au mental et à l’esprit du lecteur au moment où il le re-lit… Pour moi qui m’interroge sur le psittacisme marqué des juristes et des universitaires en général, cette propension à la répétition générée par une vision réductrice de la transmission et de l’enseignement, c’est la netteté des pages de l’ouvrage… presque sans notes de bas de page, seulement celles pour permettre d’identifier ce qu’il regarde pour étayer ses hypothèses : quelques auteurs sont ainsi mentionnés qui n’ont pas dit avant lui ce qu’il veut dire mais qui sont en quelque sorte l’objet de son propre discours : en bref, Michel Foucault avait semble-t-il quelque chose à dire par lui-même et de lui-même. Ce qui est frappant, c’est que cet ouvrage lui ait permis d’entrer d’emblée dans le panthéon des intellectuels français, sans que, du point de vue de ce qu’il y révèle, c’est-à-dire une autonomie véritable de la pensée, il ait fait date.
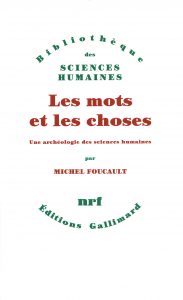 Boaventura de Sousa Santos, Vers un nouveau sens commun juridique. Droit, science et politique dans la transition paradigmatique, trad. de Nathalie Gonzales Lajoie, L.G.D.L., coll. Droit et Société, série sociologie, n°39, 2004.
Boaventura de Sousa Santos, Vers un nouveau sens commun juridique. Droit, science et politique dans la transition paradigmatique, trad. de Nathalie Gonzales Lajoie, L.G.D.L., coll. Droit et Société, série sociologie, n°39, 2004.
Le marxisme est démodé, surtout chez les juristes, et surtout chez les juristes français. Pourtant, que le marxisme soit seulement une filiation plus ou moins revendiquée ou une adhésion actualisée de la pensée de celui que le site Wikipedia présente comme « un historien, journaliste, philosophe, sociologue de l’économie, sociologue, essayiste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand », il est encore assez vigoureux et présent à l’étranger. Il existe ainsi par exemple une littérature juridique pro ou para-marxiste anglo-saxonne. Boaventura de Sousa Santos est portugais et a fait sa thèse de sociologie du droit à Yale. Il combine ainsi plusieurs traditions dont le résultat est assez intéressant. Il livre avec cet ouvrage traduit en 2004 une « somme », mélange de sociologie expérimentale et de terrain, d’épistémologie, d’histoire politique et juridique et de philosophie politique et juridique. Son ambition est affichée par le titre « Vers un nouveau sens commun juridique », pour lequel il plaide, qui passe par une transformation paradigmatique à l’œuvre, mais à laquelle on doit vouloir ou non donner un « coup de pouce ».
Boaventura de Sousa Santos estime que la connaissance scientifique est « une connaissance minimum qui ferme la porte à nombre d’autres façons de connaître le monde », elle est donc « une connaissance triste, désenchantée qui transforme la nature en automate ou, comme dit Prigogine, en un interlocuteur terriblement stupide » (p. 27). Il est ainsi temps de changer d’épistémologie au profit de la connaissance « émancipation ». L’ouvrage se découpe ainsi en théorisation juridique de l’histoire du capitalisme depuis le XVIIIè siècle jusqu’à aujourd’hui, description des processus qualifiés de « localisme globalisé » ou de « globalisme localisé », et expériences juridiques singulières dans des territoires restreints et néanmoins vastes (favelas). L’entreprise générale de l’ouvrage est courageuse et vaut le détour, même sur plus de 500 pages.
Décembre 2016
Bernard Lahire, Ceci n’est pas qu’un tableau, essai sur l’art, la domination, la magie et le sacré, éd. la Découverte, 2015.
Voilà une mise en application immédiate de mes propos sur la référence et la citation (voy. mon texte La driférence) : bien des fois dans cet ouvrage l’auteur suscite mon adhésion, et pourtant, au détour de quelques phrases, je m’aperçois que sa conception de la science reste finalement éloignée de la mienne. Je dirai donc en quelques mots ici, en quoi cet ouvrage mérite attention selon moi, et en quoi cependant je me détache « un peu » de la démarche de Bernard Lahire.
L’ouvrage est une réflexion poussée sur la manière dont l’espace social s’organise autour de phénomènes dont le principe actif reste fondamentalement la magie et le sacré, en dépit de ce qu’on a pu dire sur un certain désenchantement du monde : il faut, dit Bernard Lahire, « affirmer la présence fondamentale, centrale, de la magie et du sacré, de l’envoûtement et e la foi au cœur des pratiques sociales contemporaines, et notamment dans l’économie des relations de pouvoir » (p. 78). Cela paraît presque comme une évidence, et on s’étonne qu’il s’agisse là d’une découverte. Quoi qu’il en soit, l’origine de cette réflexion est l’ensemble des événements et discours qui ont été et qui se sont produits autour de la découverte d’un tableau dont la paternité fut finalement attribuée officiellement au fameux peintre Nicolas Poussin (affaire dont je me souviens qu’elle avait fait très rapidement les choux gras des enseignants qui introduisaient au droit en ayant un bel exemple d ‘ « erreur sur la substance de la chose »). Mais l’ouvrage de Bernard Lahire est aussi l’occasion pour lui de démontrer que seule une recherche mêlant plusieurs disciplines, ce qui l’obligea à prendre connaissance de nombreux faits et réflexions en dehors de son champ disciplinaire propre, était de nature à produire une telle réflexion. Ce qui fait que le début de l’ouvrage comme la fin établissent des constatations en quelque sorte « négatives », : « les historiens s’arrêtent là où les sociologues sont censés commencer à s’interroger, les sociologues de l’art s’aventurent rarement sur les terrains de l’histoire religieuse, de même que les anthropologues du politique laissent à d’autres confrères le soin de poser la question de la magie, ou que les sociologues du droit ne vont pas s’occuper de science s ou d’art, et ainsi de suite. Peu à peu, ce sont des proximités ou des analogies que l’on ne voit plus, des phénomènes transversaux que l’on n’est plus en mesure de déceler, des relations d’interdépendance entre domaines de pratiques qui échappent par définition à l’analyse centrée sur un domaine ou un sous-domaine déterminés, et des questions ou des problèmes sont ignorés de part et d’autre des différentes frontières disciplinaires ou sous-disciplinaires » (pp. 25-26-). Ce constat, largement développé par l’auteur, suscite évidemment mon adhésion entière, tout comme les développements importants sur la démarche, inverse donc, qu’il entreprend dans cet ouvrage, le conduisant ainsi à recourir à de multiples champs d’analyse que, en tant que chercheurs, il intériorisera lui-même pour le bien de sa propre analyse. C’est l’objet des 5 premiers chapitres, et suit ensuite la description assez longue de l’affaire Poussin sur les 4 chapitres suivants. Je vous laisse naturellement le privilège de la découverte, mais pas sans préciser une chose : à partir de la page 281, Bernard Lahire s’interroge sur la notion de vérité scientifique et est ainsi conduit à une attitude tout à fait étonnante, en posant la condition de la remise en cause du savoir sans donner la possibilité réelle de sa remise en cause. Je m’explique : il indique « qu’un savant complet devrait non seulement chercher la vérité de certains faits, mais s’interroger aussi sur les ‘raisons’ ou les ‘conditions’ qui le poussent à chercher dans telle ou telle direction »… on ne peut être que d’accord avec cela. Et il indique aussitôt qu’ « une telle réflexivité ne constitue pas une remise en cause de la démarche scientifique ou une relativisation de la recherche scientifiquement réglée, mais repose sur une prise de conscience des états de faits et des socles de croyances dans lesquels les savants inscrivent, le plus souvent non consciemment, leurs travaux. »… on peut donc être rassuré, la science reste la science, en dépit de tout… c’est bien dommage tout de même.
L.F. décembre 2016
Eté 2016
C’est un fil particulier que nous a proposé Pierre Legendre en 1984, par la réunion de quelques textes d’Ernst H. Kantorowicz, dont l’un est intitulé Mourir pour la patrie, qui donne son titre au recueil. Au moment où une rétrospective du Cinéma de Pierre Legendre s’édite en coffret (4ème trimestre 2016, à vos lecteurs !), il n’est pas seulement intéressant de s’intéresser à ses œuvres, mais aussi à ce à quoi il trouvait intérêt chez les autres. En 1984, Mourir pour la patrie (éd. PUF) propose de réfléchir, par la médiation d’une réflexion sur la pensée et les pratiques médiévales, à la manière dont on pense le droit et la fonction du droit dans le rapport de l’Homme au monde. Le statut de la politique et de la science est interrogé dans un même mouvement.
Nous voilà rapidement prévenus par l’initiateur du recueil : « là où se profile la question de la vérité et du pouvoir, les mécaniques institutionnelles semblent devoir fonctionner aussi pour la noyer (…) »[1].
Si à cet égard Pierre Legendre considère que « l’érudition demeure une carte si violemment efficace »[2], en référence à l’usage par les nazis de l’œuvre de Kantorowicz, Frédéric II, devant lequel ce dernier demeurait interdit, je considère pour ma part que, plus que l’érudition, il s’agit d’une manière d’appréhender les choses qui peut être véritablement efficace, que l’érudition nourrit, en bien ou en mal. Ce qu’analyse donc Kantorowicz dans les textes de ce recueil, ce qu’il choisit de mettre en lumière dirais-je, se trouve donc à la disposition de tous, mais son usage sera déterminé par le niveau d’appréhension de ses lecteurs, ne l’oublions pas.
« A la volée », je livre quelques analyses de kantorowicz qui peuvent entrer ou non dans l’espace de nos/vos réflexions :
– la fiction est « l’art du juriste qui la dote d’une vérité et d’une vie propre »[3],
– et, par ailleurs, « l’essence de l’art des juristes », qui consistait à transférer une choses d’un champ à l’autre, et considérait « en des termes équivalents deux ou plusieurs sujets qui, a priori, semblaient n’avoir rien à faire ensemble. Par exemple, l’église, une ville et un fou étaient d’un point de vue technique sur le même pied d’égalité, car considérés comme ‘mineurs’ », et avaient donc tous besoin d’un tuteur[4].
– « Dès qu’(…)un fisc impersonnel se fut imposé en tant que personne fictive, la question du rapport roi-fisc s’imposa, indéménageable »[5],
– et, « La contrepartie du langage théologique à des institutions séculières fut que d’une part, le fisc et la machinerie étatique devinrent effectivement semblables à Dieu, alors que, d’autre part, Dieu et le Christ se trouvèrent rabaissés au rang de simples symboles d’une fiction juridique dans le but d’expliquer l’ubiquité et l’éternité de la personne fictive appelée fisc »[6] ;
– ce faisant, écrit enfin Kantorowicz dans le texte Mourir pour la patrie (Pro Patria Mori) dans la pensée politique médiévale qui clôt le recueil, « Nous sommes sur le point de demander au soldat de mourir sans proposer un quelconque équivalent émotionnel réconciliateur en échange de cette vie perdue »[7].
Il me semble qu’il n’est pas possible de laisser ces réflexion en l’état, c’est-à-dire de ne pas interroger continuellement le rapport qu’une société entretient avec son droit, ses fictions et ses mythes, sans négliger que chacun intériorise singulièrement cet ensemble.
[1] p. 18. Voy. également le texte de présentation des textes du recueil par Pierre Legendre sur le site de Patrick Valas : http://www.valas.fr/Ernst-H-Kantorowicz-Mourir-pour-la-patrie,096)
[2] Ibid. p. 17.
[3] La souveraineté de l’artiste. Notes sur quelques maximes juridiques et les théories de l’art à la Renaissance, p. 38.
[4] Ibid. p. 51.
[5] Christus Fiscus, p. 65.
[6] Mystères de l’Etat. Un concept absolutiste et ses origines médiévales (bas Moyen Age), p.99.
[7] p. 139.
L.F. 27 juillet 2016
Jack Goody est surtout connu pour son ouvrage La raison graphique[8], mais c’est pour l’heure à l’un de ses derniers ouvrages que je m’intéresse, Le vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, parue d’abord chez Gallimard en 2010, puis aux éditions Folio en 2015. Le propos général est assez simple : montrer que l’histoire telle qu’elle se raconte en Occident et en Europe reste sérieusement « occidentalo-centrée » ou « européo-centrée », même quand elle se raconte avec une conscience minimale de ce travers.
Si le propos est aisément compréhensible et plutôt intuitivement convaincant, je ne peux pas dire que l’ensemble des chapitres proposés l’illustrent à merveille : affirmations et démonstrations souvent « rapides », qui laissent sur sa faim et qui ne provoquent pas complètement l’envie de chercher plus loin. Un chapitre toutefois m’a paru plus décisif que les autres, le chapitre IV intitulé « Qui a volé quoi ? Le temps et l’espace » (pp. 189 et s.)[9]. Un fait en particulier a retenu mon attention qui constitue pour Jack Goody l’illustration de ce que « le temps et l’espace, tels que nous le concevons aujourd’hui, sont deux dimensions qui nous ont été imposées par l’Occident (p. 190). A propos de l’invention de l’Horloge, et comme le rapporte l’ambassadeur Ghiselin de Busbecq dans une lettre de 1554 à laquelle se réfère Goody, la lenteur de l’adaptation du Proche Orient « n’est pas due, comme d’aucuns l’ont supposé, à une résistance généralisée à l’innovation : ‘Aucune nation ne s’est montré moins réticente à adopter les inventions utiles venues d’ailleurs (…). Cependant, ils n’ont jamais pu se résoudre à (…) installer des horloges dans les lieux publics. Ils prétendent que (…) s’ils installaient des horloges dans les lieux publics, l’autorité d leurs muezzins et de leurs rites ancestraux s’en trouverait diminuée’ » (pp.197-198). Jack Goody ponctue l’ensemble de ses développements sur le temps en concluant que « toute idée d’un mode de calcul exclusif, linéaire ou circulaire, est une idée fausse qui reflète la vision que nous avons d’un Occident avancé, regardant loin devant, et d’un Orient statique regardant derrière lui » (p. 199). « Derrière » justement, c’est là que les chinois envisagent plutôt l’avenir, parce qu’il n’est pas visible. Considérant cela et à la manière chinoise de marcher à reculons pour avancer (c’est très bon pour le dos !), on dira que l’histoire n’est donc pas derrière mais devant nous, pour qui veut la voir
[8] La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Éditions de Minuit, 1979.
[9] A cet instant je pense que c’est exactement le même sentiment que j’avais eu à la lecture de l’ouvrage de Jacques Commailles, A quoi sert le droit ?, où c’est le chapitre consacré au temps qui m’avait paru le meilleur : voy. le bas de cette page pour mon sentiment à propos de l’ouvrage.
L.F. 27 juillet 2016
Décembre 2015
… Rarement en effet je peux retirer de la lecture d’un travail de recherche le sentiment d’en apprendre beaucoup sur ce qui fait habituellement le centre de mes intérêts, à savoir le droit : c’est à un historien que je dois cette sensation récemment. Je ne peux donc que recommander la lecture, difficile parfois en raison de ce qui y est rapporté, de La loi du sang. Penser et agir en Nazi, de Johann Chapoutot, paru chez Gallimard en 2014 dans la collection Bibliothèque des histoires. Un ouvrage qui a un propos, mené de bout en bout, à partir de matériaux largement inexplorés jusqu’alors. On ressort de cette lecture, si on a fait l’effort de vouloir en retirer quelque chose, plus acéré sur les liens entre les discours et le droit.
C’est une autre histoire que celle-ci, bien qu’elle soit liée à la précédente, puisque Claude Lévi-Strauss, dont s’agit, a connu l’exil pendant la période nazi, pendant laquelle d’ailleurs il ne fut plus que Claude L. Strauss, pour ne pas être confondu avec la célèbre marque de pantalon. Vous trouverez cela dans le cadre d’un décryptage du cours de la vie de Claude Lévi-Strauss, à partir d’un ensemble vaste d’informations et de documents, analysés par Emmanuelle Loyer. L’analyse est à la fois orientée et discrète, qui laisse place aux liens que le lecteur voudrait faire lui-même sur les éléments de la vie qu’il découvre de Claude Lévi-Strauss dans ce livre, et ce qu’il en connaît – et retire – de son oeuvre écrite. Emmanuelle Loyer, Claude Lévi-Strauss, Flammarion, 2015.
Le travail d’Alain Supiot est « exceptionnel » au sens premier du terme : voilà un juriste qui regarde beaucoup ailleurs que dans les normes pour y trouver leur sens et portée véritable. Bref, voilà quelqu’un qui ne s’arrête pas à la lettre de la loi et qui prend cette idée au sérieux. Soucieux du « social « , Alain Supiot analyse son objet par référence à un champ d’investigation extrêmement large, de l’économie à la philosophie indienne, dans lequel il cherche à identifier les points de contact, c’est-à-dire comment s’articulent les différents éléments qui constituent le social. Cette démarche est, je le répète, relativement exceptionnelle, car elle prend corps là où d’autres s’arrêtent à la porte du « social ». Le résultat est appréciable, qui en tous les cas ne peut pas laisser indifférent : La gouvernance par les nombres, « nouvel idéal normatif », est ainsi décrypté dans ses moindres ressorts, l’histoire étant un instrument précieux de l’analyse. Fayard, 2014.
C’est en raison du chapitre V que je parle ici de ce livre : Jacques Commaille est je crois peu lu chez les juristes, sans doute en raison de sa très grande proximité avec des sociologues. On trouvera dans son dernier ouvrage beaucoup de choses qu’on a déjà pu trouver auparavant chez cet auteur, et notamment – mais c’est personnel – une certaine difficulté à identifier, au-delà d’une érudition certaine sur les différents courants et analyses qui traversent la pensée juridique depuis ces quarante dernières années, une véritable position de l’auteur. Pour moi c’est un critère. Mais je dois dire que j’ai été franchement intéressée par ce fameux chapitre V consacré aux « temporalités du droit », très dense, et qui sans doute aurait mérité d’être la trame véritable de l’ouvrage. C’est là qu’on peut le mieux déceler les liens qui unissent les discours au droit, et réciproquement évidemment… Mais je l’ai déjà dit pour l’ouvrage de Johann Chapoutot ci-dessus : chez Commaille ça se perçoit à travers la manière dont il expose les différentes temporalités du droit, chez Chapoutot cela se voit à travers un certain discours, réel, qu’il donne à voir à ses lecteurs et qu’il relie au droit que ce discours a effectivement produit. Jacques Commaille, A quoi nous sert le droit ? Folio essais, 2015.